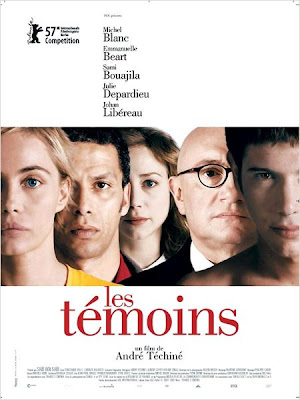Le langage du corps vaut parfois plus que celui des mots et le motif cinématographique que nous allons parcourir nous en donne l’illustration. A travers 4 images extraites de 4 films différents, nous nous demanderons en quoi ces mains qui prennent possession plein cadre du film dont elles sont issues ont-elles des dénominateurs communs. Que veut-on nous dire à travers cette monstration, comment peuvent-elles se révéler plus parlantes qu’un visage. Suivons donc les lignes de ces mains qui n’ont rien d’anodines...
KILL BILL VOL.2 (Quentin Tarantino, 2004)
Contexte :
Black Mamba (Uma Thurman), est laissée pour morte le jour de son mariage, abattue par les sbires de Bill, son ancien amant et Pygmalion qui a fait d’elle une tueuse redoutable, aguerrie à toutes les techniques des arts martiaux. Se révélant in extremis vivante, Black Mamba fomente sa vengeance qui commencera par l’élimination systématique de ses assassins et anciens collègues et qui devra culminée avec la mort de Bill. Piégée par celui qu’elle était venue tuer, Budd, le frère de Bill, la voilà enterrée vivante. Faisant appel à ses souvenirs, elle se remémore une technique enseignée par un maître d’art martiaux et qui consistait à briser à mains nues des planches de bois. Brisant ainsi son cercueil, sa main peut alors surgir des profondeurs de la terre...
X-MEN : FIRST CLASS (2011, Matthew Vaughn)
Contexte :
C’est l’introduction du film : le jeune Eric est emmené avec sa mère dans un camp de concentration. Vient l’instant déchirant de la séparation, tandis qu’on emmène sa mère, l’enfant entre dans une rage folle, entravé par les soldats qui tente de l’empêcher de la suivre. La porte en fer se referme, Eric tend la main avec ardeur vers cette mère qui s’éloigne et il va activer sans le savoir les prémices de son pouvoir. En effet, la porte en fer commence à chanceler et à se courber comme si l’enfant pouvait agir sur le métal...
SPIDER-MAN 1 (Sam Raimi, 2002)
Contexte :
Prototype du looser, Peter Parker (Tobey Maguier) n’a pas de chance. Le ton est donné par l’ouverture du film, le pauvre bougre s’époumone à demander au bus de s’arrêter alors même qu’il lui court après depuis un certain temps. Il joint l’acte à la parole : sa main vient alors se plaquer sur la vitre.
SOLEIL VERT (Richard Fleischer, 1973)
Contexte :
Dans un futur déshumanisé, le monde est surpeuplé, les gens s’entassent dans des villes crasseuses tandis qu’une élite vit recluse dans des immeubles high-tech. Les denrées alimentaires ont pour la plus part disparues, le peuple est nourri par un substitut alimentaire appelé Soylent, sorte de brique colorée. L’inspecteur de police Thorn (Charlton Heston), va être amené à enquêter sur le meurtre d’un des dirigeants de la multinationale qui fabrique et distribue cette nourriture. Ce qu’il va découvrir changera à jamais sa vision du monde. La main qui surgit est celle de l’image finale, le dernier plan du film : le héros blessé exhorte ses concitoyens à dénoncer les pratiques macabres qu’il a découvertes concernant le substitut alimentaire. Moribond, il est emmené sur une civière vers ce qu’on devine être un funeste destin car maintenant nous aussi savons ce qu’il va advenir de son corps. Le bras se lève alors, la main ensanglantée se tend pour se figer, pour nous marquer...
ANALYSE :
Elles sont toutes des actes fondateurs au sens où elles instaurent un tournant dans la vie de ceux qui brandissent ces mains. Plus rien ne sera comme avant une fois cet acte en apparence anodin réalisé : Peter Parker deviendra Spider-Man, Eric deviendra Magnéto, plus personne ne pourra arrêter Black Mamba, Thorn va probablement mourir. Il y a bien un avant et un après, le motif de la main fait figure de pivot et instaure les systèmes binaires passif/actif et de l’action/réaction.
Tous ces protagonistes vont en effet basculer d’un état de passivité marqué à celui d’activité inattendue. Peter Parker est d’emblé cet être chétif et binoclard qui court, littéralement, après sa vie, après la vie. Il a toujours un bus de retard ! Le petit Eric est brimé et entravé dans ses mouvements : on le prive de sa mère, on lui fait subir une vie qu’il n’a pas choisie. Black Mamba endure, pour la seconde fois !, sa quasi propre mort alors que Thorn, le seul qui sait, est réduit au silence définitivement.
Le chemin de vie de ces personnages est à cet instant horizontal, les aspérités qui constituent l’essence de l’existence ne sont pas, ou ne sont plus, en mesure d’être atteintes, il manque une main tendue pour se saisir de ces prises. Et c’est à cet acte vital que nous assistons à travers ces exemples : la verticalité surgit, brise la passivité et instaure une activité nouvelle. Le surgissement de la main est la figure métonymique d’une re-naissance. Ils sont tous, au moins symboliquement, morts : Peter Parker englué dans sa vie morne, Eric promis à un dramatique avenir dans le camp.
Et puis il y a ceux qui sont morts, littéralement. Black Mamba : laissée pour morte à deux reprises. Elle est celle qui a ouvertement ce qui s’apparente au statut de morte-vivante, précisons qu’il ne s’agit bien sûr pas d’une connotation surnaturelle ici. Elle renaît de la propre terre de son enterrement, ce qui permet à Tarantino de revisiter une image typique du cinéma d’horreur, en l’occurrence la main surgissant de la tombe, comme a pu le mettre en scène Sam Raimi mais cette fois-ci dans Evil Dead (1981) par exemple.
Avec cette idée que ce qui est mort et enterré ne l’est jamais tout à fait et que du dessous peut resurgir ce qui a été dessus. A l’instar de la main surgissant à la surface de l’eau à la fin de Délivrance (Boorman, 1972) lors d’un cauchemar d’un des survivants d’une expédition tragique en forêt. Le souvenir douloureux de sa confrontation sanglante avec plusieurs rednecks qui le traquaient reste vivace et la peur qu’on découvre le corps qu’il a fait disparaître dans l’eau le hante. Et c’est précisément cette image qui l’exprime, avec toujours ce conflit horizontal/vertical et cette idée de la résurgence commune à notre motif.
Quant à Thorn, il s’agit bien là d’un soubresaut de vie, la re-naissance ne durant qu’un instant pour lui mais une éternité pour le spectateur puisque l’image se fige et que cette main tendue reste levée. Le réalisateur choisit de jouer également sur la forme cinématographique en recadrant l’image, isolant en son centre et de façon rectangulaire l’image de la main tendue. Il y a ainsi une focalisation accrue, un pointage exacerbé d’un acte désespéré qui donne et insuffle une force au mourrant tout en percutant le spectateur.
Plus largement, toutes ces mains sont l’explicitation d’une force qui couve, d’un feu intérieur qui passe des braises aux flammes. Autour de la levée de ces mains il y a bien l’idée de menace, qui, comme nous suivons des personnages pour qui nous avons de l’empathie et qui ont plutôt des valeurs positives, vise le côté maléfique d’autrui. Ce tournant est donc celui de l’action, tous décident de ne plus être spectateur de leur vie mais acteur, d’être partie prenante dans la lutte qui s’engage avec l’Autre, car comme nous l’avons vu c’est bien d’une confrontation avec le monde dont il s’agit. L’action appelant une réaction, principe physique, les personnages entre dans l’après. C’est la persévérance de Peter Parker, son obstination et son désir, en passe d’être assouvi, de pouvoir agir sur ce qui l’entoure qui fera stopper le bus. C’est Mary-Jane, sa futur girlfriend, celle qu’il désir secrètement, qui finit par insister auprès du chauffeur pour qu’il s’arrête : la mécanique est en route, les réactions peuvent s’enchaîner. La main sur la vitre est déjà celle de Spider-Man, les doigts bien écartés instaurant le mimétisme avec les pattes de l’araignée. Les autres véhicules qu’il arrêtera le seront avec son pouvoir d’homme-araignée. Passage de l’humain au sur-humain.
De la même façon, le jeune Eric déclenche un pouvoir magnétique qu’il ignorait jusqu’alors, il devient un Autre, le surgissement de sa main d’humain, et ce qu’il déclenche, vient de le faire entrer dans la catégorie des mutants. Le monde ne sera plus le même pour lui et il vient d’en prendre conscience.
Si son pouvoir reste sa force et sa technique, Black Mamba met à l’épreuve la théorie pour transfigurer également ce qui l’entoure. Son désir de vengeance est le moteur, plus fort que la mort et cela l’amène à se dépasser, à franchir une étape pour devenir dans une certaine mesure, elle aussi, sur-humaine. L’expérience change l’existence.
Le cas de Thorn vibre à l’unisson des autres puisque sa main tendue est un baroud d’honneur, il est l’équivalent symbolique du poing levé contestataire, comme le brandissement était signe de rage et de colère chez les autres. Et son action appelle une réaction qui doit être celle du spectateur puisque pour lui, personnage mourrant, tout s’arrête car le film est fini, mais pour celui qui regarde, tout commence. « Dites-leur la vérité ! » hurle Thorn à ceux qui assistent à sa fin. C’est un appel à la réflexion sur une société déshumanisée, qui a franchi les limites de l’innommable et le dernier témoignage sera donc cette main, entachée de sang, symbole de la lutte, figure du martyre. C’est à nous de la saisir et de prendre le relais de celui qui a tenté d’agir et de changer ce qui l’entourait.
On le voit, tous nos personnages, à travers cette élévation de la main, surgissent d’eux-mêmes, se dépassent et accèdent à une nouvelle conscience d’eux-mêmes et du monde. Nous sommes tout à fait dans la philosophie qu' Hegel décrit lorsqu’il parle de la conscience et de la façon dont l’homme se l’approprie. Il illustre ses propos d’une image enfantine et déterminante : « La première pulsion de l’enfant porte déjà en elle cette transformation pratique des choses extérieures; le petit garçon qui jette des cailloux dans la rivière et regarde les ronds formés à la surface de l’eau admire en eux une œuvre, qui lui donne à voir ce qui est sien. »1 Comme Peter Parker ou le jeune Eric qui en changeant ce qui les entoure créent un nouveau monde dans lequel ils ont leur place et sur lequel ils peuvent agir. L’homme provoque cet état de fait « en transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le sceau de son intériorité et dans lesquelles il retrouve dès lors ses propres déterminations ».2 Thorn et Black Mamba, hissant leur main aux frontières de la mort, contemplent leur dernier signe d’humanité. Soulèvement symbolique à l’image de leurs actes et de ce qu’ils sont, qui dit au monde, et donc au spectateur, la détermination pour Black Mamba et l’espérance d’une continuité de la lutte pour Thorn. Ces mains qui surgissent s’agrippent à l’existence, elles sont toutes les incarnations d’un même cri, un cri de vie.
Romain Faisant, écrit le 14/11/11
____________________________________
1 et 2 Friedrich Hegel, Cours d’esthétique (1818-1829), t. I, introduction, texte établi en 1842, trad J.-P. Lefebvre et V. von Schenk, Aubier, colt. «Bibliothèque philosophique», 1995, p. 45-46.