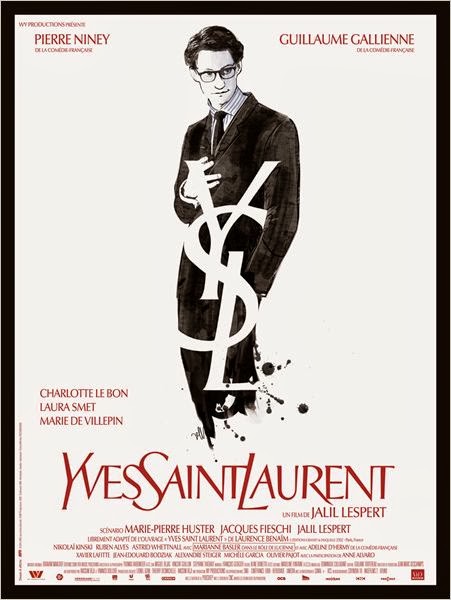Écrit et réalisé par Tobias Lindholm et Michael Noer
... Emmurés vivants
Il est des films d’où l’on sort
éprouvé, moralement et physiquement, R, réalisé par un duo danois, Tobias
Lindholm et Michael Noer, est de ceux-là. L’univers carcéral a souvent fait
l’objet de films jusqu’à en devenir un genre en lui-même, celui des
réalisateurs s’inscrit violemment dans la lignée des immersions réussies, tant
au niveau d’une réalisation cinglante par la froideur de ce qu’elle montre que des
acteurs qui transmettent la dureté absolue d’un huis clos sans concession, sans
échappatoire, sans espoir. Premier film, co-réalisé, de Tobias Lindholm
(scénariste de l’excellent La chasse, 2012)
que l’on connait en France pour le déjà marquant Hijacking (2012) dont le succès critique n’est certainement pas
étranger à la sortie (4 ans après le Danemark !) de R. On y suit d’ailleurs l’acteur Pilou Asbæk qu’on retrouvera dans Hijacking. C’est lui le protagoniste
principal, lui qui donne l’initial de son prénom (Rune) au titre du film,
focalisation lourde de sens tant elle annonce la déshumanisation, le caractère
remplaçable des intermédiaires, l’effacement d’une grande partie de soi devant
la noirceur qu’impose la survie dans cet univers. L’impact est radical et
remarquable.
« Et moi, que va-t-il m’arriver ? ». Ce sont les
premiers mots de Rune après une quinzaine de minutes où nous n’avons été
confrontés qu’à son silence mutique. Il vient d’arriver en prison et n’a pas
d’autre choix que d’obéir aux détenus pour qui il est un nouveau pion dont ils
veulent disposer pour leurs affaires courantes. Sa question s’adresse ainsi à
l’un de ceux qui lui demande de mener une expédition punitive, seul, contre un
autre détenu. Premier fait d’armes réalisé sous la contrainte. Acte inaugural
sanglant. L’amplitude de son interrogation s’étend à tout son parcours qui
n’est pas sans rappeler celui qu’avait mis en scène Jacques Audiard dans le
mémorable Un prophète (2009). Rune,
qui a de la violence en lui, fait cependant profil bas dans son quartier de
semi-liberté où les cellules sont ouvertes durant la journée. Son goût de
l’ordre et du ménage (ce sera sa seule demande : pouvoir nettoyer sa
cellule) lui permet d’acquérir un petit intérêt au sein des autres détenus (on
se sert de lui pour faire diversion en lui demandant de nettoyer les vitres de
la loge des gardiens). Paradoxalement, c’est en voulant l’humilier (nettoyage
des sanitaires) qu’ils vont lui permettre de trouver le moyen (faire transiter
de la drogue par une canalisation) d’acquérir un statut actif, là où il en
était réduit à la passivité.
Rune se distingue des autres
(baraqués, tatoués, rasés) par son allure (taille et poids moyen, cheveux
blonds), s’il semble docile dans un premier temps, l’interrogatoire musclé des
gardiens, suite à l’agression qu’il a menée, libère une rage dont on l’avait
déjà vu se contenir. Sa découverte du moyen de faire circuler la drogue va lui
conférer un certain pouvoir, lui permettant même de poser ses conditions. D’utilisé, il est devenu utile. Il sympathise avec celui qui
devient sa «mule », Rashid (Dulfi Al-Jabouri), et qui réceptionne la
drogue. L’autre moment de grâce dans cet endroit qui en est dépourvue est une surprenante
scène autour de perruches : les détenus réunis s’amusent. Contraste
saisissant rapidement annihilé.
Ce petit commerce interne montre
comment, dans ces conditions carcérales, tout est détourné de son affectation
première. La canalisation devient réceptrice, le petit œuf en plastique permet
le contenu de la drogue, la boule de billard sert d’objet d’attaque, de l’huile
bouillante devient le liquide d’une vengeance immonde…De la même façon, Rune a
été détourné, qu’il ait subi ou fait subir, il n’est plus celui qui est entré.
Sa crise de nerf intense (qui lui vaut d’être sanglé) l’enferme un peu plus
dans une spirale où le moindre faux pas vaut condamnation. Le fait qu’il se
rase le crane entérine la perte de sa propre existence et l’illusion du pluriel
(être comme les autres) là où ne s’assène que l’individualité.
La noirceur suinte à chaque plan
de ses hommes en cage, l’allusion au zoo faite par la grand-mère de Rune (dans
le contexte joyeux de l’enfance) prend un aspect sordide derrière les murs de
la prison : la loi du plus fort et du plus offrant est reine et comme dans
le règne animal, l’un finit toujours mangé par l’autre. Rune n’a-t-il pas
d’ailleurs pris la place de celui dont il a essuyé les traces de sang ? Très
bien construit dans sa forme, le film scande son atmosphère au-delà du pesant
par un récurent bourdonnement instrumental des plus anxiogène qui resserre autour
de Rune, puis de Rashid, l’implacable descente vers des abysses de brutalité. Lorsque
le film prend un virage pour changer habilement de point de vue, il en conserve
l’âpreté et l’ignoble. Chacun finit par rendre compte que ce soit pour cause
d’obéissance comme de repentance. Cette inextinguible animosité, à la
réalisation frappante, entraine chez le spectateur un vertige de stupeur.
18/01/13